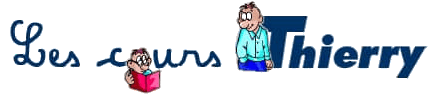La dissertation philosophique est l’épreuve reine, authentiquement philosophique car elle permet de poser un problème propre à une question comprise dans sa singularité et d’y répondre. Comment procéder ?
Sommaire :
Qu’est-ce qu’une question philosophique ?
Une question vous est posée, philosophique en cela qu’elle n’appelle pas une réponse immédiate et unilatérale. Par exemple, si quelqu’un vous demande la couleur du ciel, vous lui répondez « le ciel est bleu ». Cette réponse n’appelle pas de contradiction possible, sinon celle d’une volonté puérile cherchant à contredire pour contredire à la manière des sophistes.
En revanche, des questions comme :
- « Une œuvre d’art est-elle nécessairement belle ?»
- « Est-ce un devoir d’être heureux ?»
- « Peut-on être soi-même ?»
sont philosophiques car elles appellent des réponses nuancées qui pourraient se révéler contradictoires, et donc problématiques.

Méthode de la dissertation philosophique : principes théoriques
Avant d’éclairer la méthode de la dissertation philosophique par un exemple, voici la partie théorique en exposant les principes généraux. Pour une parfaite compréhension, s’entraîner sur d’autres sujets et bénéficier d’un suivi personnalisé, découvrez nos cours de philosophie à Paris pour les élèves de terminale.
Bien comprendre la question posée
De fait, avant d’aller plus avant, retenez bien une chose : une question est posée et il faut y répondre. Et pour cela, on ne la reformule pas, on n’en change pas une virgule, on la conserve exactement comme elle est posée. C’est à cette question dans sa singularité que l’on entend répondre, pas à une autre. Peu importe alors si elle semble bien ou mal posée, il faut l’étudier dans sa formulation précise.
Pour répondre à cette question, il faut la comprendre, et donc étudier le sens de ses termes ; mais attention, cette étude ne peut être distinguée de la volonté d’y répondre. Nombre de copies entendent analyser séparément les termes de la question en en donnant une définition spontanée, le plus souvent sans grand intérêt et, une fois ce travail fait, se sentent alors libre de le laisser de côté et de parler librement de la question en enchaînant des idées toutes faites, ce qui n’est pas du tout l’exercice demandé.
Thèse possible et contradiction
Au contraire, chercher à répondre à la question, c’est se demander :
- Si la question est posée de cette manière, que sous-entend-elle ?
- Ce qui est alors sous-entendu ne ferait-il pas naître une contradiction concernant la réponse que l’on pourrait apporter ? Et si oui, sur le sens de quels termes du sujet porterait‑elle ?
Une fois ce (long) travail réalisé, il faut choisir : quelle thèse vais-je faire intervenir en premier ? Quelle réponse vais-je donner à la question posée ? Or il faut que celle-ci soit la plus simple, la plus englobante possible. Il n’est pas lieu ici de chercher la complexité parce que les contradictions que vous poserez par la suite (et qui feront apparaître le problème) ont pour rôle de souligner les insuffisances, les limites, les cas spécifiques auxquels la thèse s’avère incapable de répondre.
Si vous vous trompez en donnant une réponse trop raffinée, trop travaillée avant d’en avoir posé une simple, votre contradiction n’en sera pas une mais se résumera en une simple opposition, ce qui n’est pas l’exercice demandé.
Formuler le problème
Une fois ce travail fait, il faut revenir à la question et se demander : « Si on a ces réponses contradictoires, qu’est-ce qui rend cette contradiction possible ? Quel sens a-t-on attribué à tel ou tel élément de la question pour en arriver là ?».
Vous trouverez alors dans la question posée le point précis sur lequel porte le problème qui sera alors à formuler le plus clairement possible sous la forme : mais alors si X (la notion à étudier dans la question) peut être ainsi compris, comment se fait-il qu’il puisse également être compris comme cela ?
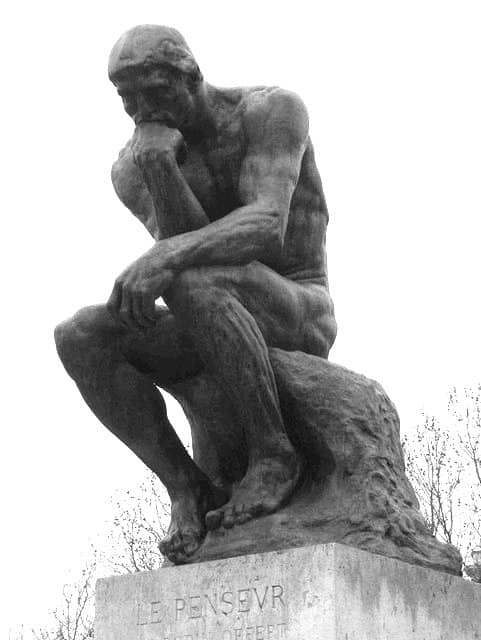
Exemple de dissertation : « Peut-on être soi-même ?»
Introduction
Explication du sens de la question posée
La question porte ici sur la possibilité d’être soi-même et sous-entend que ce soi-même est une chose qui se situe hors de moi, qui me transcende, et à laquelle je pourrais, ou non, accéder par mes actions. Sont donc ici interrogées les conditions de son accès.
Thèse
Pour être soi-même, il faut faire des efforts pour rester fidèle à ses valeurs et se forcer à agir en conséquence, ne jamais se décourager. Autrement dit, pouvoir être soi-même est une question de volonté d’agir. D’ailleurs, comment pourrais-je ne pas être moi-même ? Car il semble vain de vouloir agir contre sa nature (« chassez le naturel, il revient au galop »).
Contradiction
Cependant, il m’arrive parfois des événements qui m’empêchent de pouvoir être moi‑même : je suis peintre, on m’annonce que je serai bientôt aveugle. Je ne pourrai plus exercer mon activité, et donc être moi-même.
Problème
Quelles sont alors les limites de la possibilité d’être soi-même ? Est-ce une simple affaire de volonté, ou existe-t-il des causes extérieures qui m’empêchent de pouvoir être moi-même ?
Clarification
Pouvoir être soi-même, est-ce une action libre (partie I), ou déterminée (partie II) ?
Dépassement
Pouvoir être soi-même ne serait-il pas dès lors à comprendre comme la liberté de choisir ce qui nous détermine (partie III) ?
Développement en trois parties
Cet exemple d’introduction est succinct, mais une fois l’introduction annoncée, votre développement sera traité en trois parties (I, II, et III), chacune exposant elles-mêmes des idées et des arguments pour justifier la thèse (généralement en trois sous-parties).
Vous raisonnerez alors par vous-même pour produire votre propre pensée, mais vous devrez vous servir de la pensée des auteurs étudiés en classe pour nourrir votre argumentation. N’oubliez pas que c’est toujours vous qui raisonnez, pas le philosophe dont vous ne faites que vous servir.
Chacune des trois grandes parties est séparée des autres par une transition sous la forme d’une question qui reformulera la contradiction (entre I et II), puis la possibilité du dépassement (entre II et III).
Exemple de plan en 3 grandes parties
- Partie I
- idée 1
- idée 2
- idée 3
- Transition contradiction
- Partie II
- idée 1
- idée 2
- idée 3
- Transition dépassement
- Partie III
- idée 1
- idée 2
- idée 3
Conclusion
La conclusion sera le récapitulatif du cheminement intellectuel parcouru et répondra ainsi clairement à la question posée. A l’instar de l’explication de texte, aucune ouverture n’est conseillée.
J’interviens en Français avec le souci constant de répondre au plus près des besoins des élèves de collège et de lycée dans un espace inédit de travail en petits groupes.
N’hésitez pas à poser vos questions en commentaires !